 |
|||||
|
|
|||||
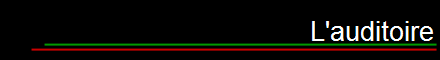 |
|
|
|
La tentative de suppression des offices et l'adaptation territoriale des baillages constituent ce qu'on appelle: ''la réforme du chancelier Maupéou'', à la fin du règne de Louis XV, alors que ce roi n'est déjà plus le ''bien-aimé'' Cet épisode de réorganisation administrative illustre la lutte sans merci à laquelle se livrent le parlement, institution judiciaire suprême de la Royauté, à l'époque des despotes éclairés. Elle se concrétise à Beauvoir par l'édification près de l'église du village d'un bâtiment qui a encore fière allure de nos jours, en forme de tour carrée avec des angles et des corbeaux en pierre noire et un toit à quatre pentes. On l'appelle parfois ''presbytère'' ou ''pavillon de justice'' mais son nom véritable repris dans un marché public datant de 1771 est: ''Auditoire de justice''. L'AUDITOIRE DE JUSTICE… Simple remise communale qui a aujourd'hui néamoins encore fière allure. L'histoire peu banale de l'Auditoire de Justice de Beauvoir' mérite d'être racontée car il s'agit de la concrétisation d'une expérience ponctuelle voulue par le Roi pour faire face à l'anarchie de l'administration et à l'insécurité qui sévissent alors partout en France dans le ''plat pays'' c'est à dire en dehors des villes. Il fallait pouvoir passer outre aux grèves et remontrances de la basoche qui défendait ses privilèges avec l'appui de certains nobles. Nous n'avons retrouvé aucun document marquant les intentions des protagonistes de cette réorganisation locale, mais les lettres patentes consultées et le contexte politique de l'époque nous permettent de reconstituer aisément ce coup fourré. Son but est tout simplement de définir un nouveau modèle élémentaire pour le contrôle du prélèvement de l'impôt et de l'administration de la justice à l'échelon d'un groupement de paroisses. Louis XV initiera le projet, Louis XVI le confirmera par un règlement de police. L'affaire commence par une requête des chanoines du Chapitre de l'Eglise cathédrale St Etienne d'Auxerre, présentée où Roi en son conseil et concernant la mauvaise administration dans leurs paroisses, terres et seigneuries de Pourrain. Parly, Merry la Vallée. Beauvoir. Saint Martin sur Ocre, Egleny et Lindry situées dans le ressort et coutumes du baillage d'Auxerre et toutes contiguës les unes aux autres''. Or, les officiers résidant dans ces paroisses ont remarqué que la rareté des affaires entraînent des dysfonctionnements: ''L'officier se trouve à l'audience lorsqu'il n'y a pas d affaires et les parties s'y trouvent lorsqu'il n'a pas d'officiers''. Voilà, avant la lettre, un problème d'aménagement du territoire! Le préambule des lettres patentes précise encore que: "c'est particulièrement grave dans les affaires criminelles'', car ''cela peut faire dépérir les preuves et procurer l'impunité des coupables''. Donc le Roi ordonne que: ''ces sept communes de la Vallée d'Aillant soient réunies en une seule et même juridiction, dont la justice sera exercée et administrée à Beauvoir par un bailly, un lieutenant, sept procureurs fiscaux et un greffier. En outre, ''sur provisions qui leur seront données par le chapitre, ils nommeront huissiers, sergents et procureurs en nombre suffisant'. Alors que de toujours les administrations maintenues au chef-lieu de canton voient leur effectif contesté, on peut s'étonner du nombre de ces nouveaux fonctionnaires. Il faut considérer cependant que les conseils municipaux n'existaient pas et que les brigades de la Maréchaussée n'étaient qu'au nombre de 765 pour 28.000.000 d'habitants en France (elles sont 4.000 pour la Gendarmerie aujourd'hui). Par ailleurs, au départ, les procureurs fiscaux seront évidemment les sept officiers résidant déjà dans chacune des paroisses concernées. Leur statut risque d'être changé très vite en celui de commissaire rémunéré. C'est là le noeud de l'affaire mais ce n'est bien sûr pas dit! Enfin, le Roi exprime clairement son intention quant au fonctionnement de la nouvelle organisation ''Voulons et nous plaît que la justice s'exerce et s'administre au lieu de Beauvoir-Auxerrois, auquel lieu, les dits sieurs du Chapitre seront tenus d'entretenir Auditoire et avoir bonnes et sûres prisons...Poteau de justice tel qu'à Haute justice appartient... et feront les audiences une fois par semaine." La décision est prise. il reste à passer à l'acte... ''…Les lettres patentes sont rapportées à notre Cour de Parlement….elle en a ordonné l'exécution et l'enregistrement par arrêt du 3l janvier 1769...'' disant que: ''cette réunion de justice va produire un très grand avantage à leurs vassaux et nos sujets desdites paroisses ce qui engage à en presser l'exécution. Mais n'ayant au lieu de Beauvoir ni auditoire ni prisons...celà va occasionner une dépense de 8.000 livres...50 arpens de bois mis en réserve au lieu de Merry la Vallée seront suffisants pour fournir la somme nécessaire.. et attendu la modicité de l'objet et la dispense de formalité de lettre patentes...vu les pièces attachées à ladite requête|..." Chanoines vous n'avez plus qu'à construire... . Ce qui est fait assez rapidement puisque le marché est établi le 15 avril 1771 moyennant 8.700 livres et 24 soles vin...sauf fournir les bois de charpentes''. On peut penser que la réception de la construction est faite à la date prévue, à la St. Martin. 11 novembre de la même année. Voilà donc une décision politique bien engagées et avant de revenir sur l'institution ainsi créée, dans son contexte général, dans le choix du lieu, et dans les résultats attendus, examinons simplement le bâtiment à son origine. ''L'auditoire sera placé au lieu indiqué par le devis..plus ou moins près de l'église. Les marches extérieures pour l'entrée de l'Auditoire et pour descendre dans la cour des prisons seront chacune d'une seule pièce. Les volets seront de sapin... et sans emboîture, mais garnis chacun de trois barres clouées avec toute la solidité possible. Au lieu de volets à la croisée entre les deux portes de l'auditoire sera fait un treillage en fil de fer monté sur un chassis en bon bois de chêne bien scellé avec pattes suffisantes." Il faut n'est ce pas se méfier des réaction parfois violentes de malandrins qui ne sont pas toujours bien encadrés. ''Sera fait dedans le barreau deux places avec appui devant pour placer les procureurs fiscaux". Les commodités ou lieu d'aisance seront placées au fond de la cour des prisons et la fosse d'aisance aura seulement huit pieds au carré et six pieds sous clef. On agrandira la première cour le plus que faire se pourra sans nuire à l'entrée des prisons qui seront à deux chambres sous voûte séparées l'une de l'autre par un bon mur". On imagine donc bien cet ensemble dans sa fonctionnalité avec ce grillage faisant frontière entre les prisons au Fond et les magistrats du côté de l'entrée. Revenons donc au niveau des intentions ce qui est primordial pour cette petite paroisse qui n'en demandait pas tant. LES RESSORTS POLITIQUES DE LA DECISION: En février 1760, la création d'un impôt du vingtième portant sur l'ensemble de tous les revenus a relancé la querelle avec le Parlement qui refuse d'enregistrer l'édit.. Après diverses péripéties,Sa Majesté fait marche arrière et les magistrats qui avaient cessé leur service le reprennent en grande pompe. En 1762, Le ministre Bertin annonce un contrôle des privilèges. La révolte des parlements de Province est cette fois telle que les impôts nouveaux ne peuvent être levés. Louis XV, une fois de plus, capitule (1765). Puis les positions se durcissent à la suite de l'envoi de lettres anonymes au secrétariat de la Maison du Roi, attaquant la personne royale. Cette affaire se superpose à des scandales dénoncés par Voltaire et qui déconsidèrent les parlements de Toulouse et de Paris. Maupéou, ancien premier président du parlement de Paris devenu vice chancelier et garde des Sceaux est un homme intègre qui sait présenter ses idées au Roi. En cette année 1768, ce dernier lui fait tellement confiance que la chute du ministre Choiseul est déjà inévitable de même que l'arrivée de l'abbé Terray au Finances (1769). Dans ce redéploiement stratégique de l'administration, la mise au point d'une maquette locale à l'insu des parlements concernés est donc d'une grande importance. Il faut donc bien choisir l'endroit. LE CHOIX DU LIEU: Ce sera ce petit territoire du Comté d'Auxerre , à la naissance de la vallée du Tholon qui a pour caractéristique importante de se situer à l'intersection de trois frontières historiques L'Orléanais pour Saint-Martin sur Ocre, la Champagne pour Egleny. Merry la Vallée, le Duché de Bourgogne pour Parly, Lindry, Pourrain et Beauvoir en position centrale. Cette situation de marges imprécises fait qu'il sera difficile aux Parlements de Paris, de Dijon et d'Orléans de retrouver leur compétence territoriale (compétence ''ratione locci"). Cela permettra le cas échéant de brouiller les cartes. Par ailleurs, et sans doute pour convaincre le Roi, que chacune des communes n'est pas à plus d'une lieue de Beauvoir, un petit croquis avec ses triangles de liaison entre les villages est établi . Mais pourquoi choisir Beauvoir l'Auxerrois comme chef-lieu de justice de ces sept paroisses? Là aussi, le calcul est évident: on prend la plus faible, qui de toute façon se réjouira qu'on construise un bâtiment coûtant 8.000 livres sur son territoire (11). Huit mille livres, cela représente 4 années des bénéfices tirés de la paroisse par les chanoines du chapitre de l'église cathédrale de Saint Etienne d'Auxerre. Pour ces derniers, l'investissement paraît aussi très rentable au prix de la paix publique à en attendre et du caractère exemplaire et innovant du projet qu'ils ne manqueront pas de faire appliquer sur les paroisses voisines. Beauvoir, la plus faible de ces sept communes? Pour s'en convaincre, écoutons'. "Les doléances, plaintes et remontrances que font très humblement les habitants de la paroisse de Beauvoir Auxerrois vingt ans plus tard pour la convocation et la tenue des Etats Généraux du Royaume: "article 1er. La paroisse des plaignants est une des moindres qu'il y est peut-être dans la généralité de Paris et ne compote que 80 habitants dont les deux tiers sont de pauvres manoeuvres qui n'ont presqu'aucune propriété. Le territoire très peu étendu et de mauvaise qualité, qui ne produit que par l'industrie des citoyens. La meilleure et la principale partie de leur revenu, consiste en fruits des châtaigniers, des noix, des poires,des prunes et du vin. La grande rigueur de la gelée de cet hiver dernier a gelé presque tous ces arbres au point qu'il faut les arracher, ce qui fait un tort très considérable pour les plaignants. Ce sont les chanoines du chapitre cathédrale Saint Etienne d'Auxerre qui sont seigneurs de cette paroisse, sont gros décimateurs, outre ce, sont propriétaires de la majeure partie des meilleurs fonds et de beaucoup de rentes" Ainsi, désigner Beauvoir l'Auxerrois comme chef-lieu de justice, c'était aller à contre courant des échanges naturels entre ces sept communes, mais ça ne laissait pas de place à la contestation . LES RESULTATS DE L'EXPERIMENTATION L'auditoire de justice a fonctionné jusqu'en 1790 et les minutes du greffe du baillage de Beauvoir sont intéressantes à consulter . Ainsi : Le 9 juillet 1772, un réquisitoire du procureur de Pourrain contre les| excès du libertinage. Une procédure contre Girard de Lindry inculpé d'avoir donné des jetons de cuivre pour des louis d'or. En 1773, une procédure pour vol de grain, dont les auteurs sont condamnés, les uns aux galères, les autres du bannissement. En 1774, une information sur les méfaits d'une bande demeures gens de Lindry. ...mais, ce sont là de petites histoires qui méritent d'être contées par ailleurs. Il est aussi intéressant de voir que les textes novateurs essentiels de l'époque, relatifs notamment au commerce des grains et à la police générale tiennent compte de la nouvelle organisation. Ainsi, une ordonnance de police du 20 novembre 1777 fixe pour "la justice de Beauvoir et autres y réunies" le salaire des meuniers pour le moulage des grains (voir Annexe). Plus important, un règlement de police applicable aux sept communes, signé par le roi XVI lui même, le 26 novembre 1778, est homologué par un arrêt de la cour du parlement de Paris le 19 mai 1779 On retrouve les préoccupations principales de l'époque pour maintenir le bon ordre: Eviter les incendies, les dégâts aux récoltes, et les empiètements sur les chemins. (Voir la table des sommaires de ce règlement de police) La responsabilité civile des pères et mères, maîtres et maîtresses est, également, mise en évidence. Ils seront responsables des amendes qui pourront être prononcées pour contravention à cette ordonnance" Il est intéressant aussi de noter que le "Banc de vendanges" était donné par le juge (aujourd'hui par le Préfet) et que des "Meffiers" étaient élus dons chaque paroisse dans le mois de janvier pour veiller à la garde et conservation des fruits et héritages de la campagne. Voilà donc les précurseurs des garde champêtre du 19ième siècle..et de l'appellation courante des hommes.. Epilogue La maison de justice de Beauvoir l'Auxerrois, on pourrait l'appeler ainsi simplement, de nos jours, est mise en valeur au centre du village. Eclairée le soir, on la voit depuis la côte de Chevreau après Lindry, en venant d'Auxerre . Son histoire méconnue méritait d'être rappelée, dans l'espoir de lui redonner ce nom qu'elle a injustement perdu qui rappelle le rôle de premier plan qu'elle a joué. Témoin d'une organisation trop tardive pour être un modèle, et oubliée après la tourmente révolutionnaire, elle est cependant un bel exemple de l'aménagement du territoire "à là la françaises". A partir d'un schéma rationnel Beauvoir l'Auxerrois, 24 avril 1995 Guy JOLY RENVOIS 1) Coup fourré: en escrime:. Coup porté et reçu en même temps par chacun des deux adversaires; permet de déjouer un adversaire qui ne se méfie pas. 2) Chat fourré: surnom donné aux juges par Rabelais. 3) Offices: anciennement charges acquises et héréditaires pour les officiers de justice. Les officiers seront remplacés par Maupéou par des commissaires payés. 4) Baillage: Circonscription territoriale d'un officier d'épée ou de robe qui rendait la justice au nom du Roi ou d'un seigneur.|Ainsi, en 1745, Claude BABELLO était reçu dans l'office de Bailly, pour les paroisses d'Egleny, de Beauvoir de Pourrain, Merry la vallée et Parly. 5) Basoche: communauté des clercs dépendant des cours de justice. 6) Lieutenant: lieutenant criminel officier de justice. 7) Poteau de justice: successeur des ''signes patibulaires'' du Moyen-Age. Les lieu-dits ''justice'' ou ''potence'' marquent leurs anciens emplacements. Ainsi, en limite des communes de Beauvoir et de Parly. au bord de la D 304 un chataignier tricentennaire ''La potences", et, cent mètres plus au nord la parcelle ''Justice'' dont l'appelation a disparu au dernier remembrement. 8) Saint-Martin sur Ocre: le prieuré de Jeuilly relevait de l'Abbaye de la Charité sur Loire. 9) Egleny: ancienne étape sur la route de St. Jacques de Compostelle. 10) Merry la Vallée: a été donné au chapitre cathédrale d'Auxerre. l 1) A une époque très récentes un silo à grains qui domine tout le paysage s'est implanté au lieu-dit le Donjon sur le territoire de la commune de Pourrain. Il ne cause des désagréments qu'à la commune de Beauvoir et laisse les avantages de l'autre coté de la route. 12) Les châtaigniers : il en reste encore beaucoup sur le territoire de la commune de Beauvoir, et même de cette époque. Le plus grand danger pour eux n'est pas le gel mais la tronçonneuse des bûcherons sous prétexte de sécurité routière. 13) Les doléances : L'art. II porte sur les droits pour la production des vins, l'art. III sur les charges d'huissier. l'art. IV sur la corvée d'entretien des chemins et le texte est signé par : J. JOLY- GIRARD- C. JOLY- E. BOULMEAU- DURVILLE- ROCHE- E. VIEL-SERVIN-J MASSOT- RAVIN. Patronymes ayant pour la plupart des représentants dans la commune aujourd'hui. D'après des sources recoupées, et notamment les publications de l'abbé Noirot sur la vallée d' Aillant, Beauvoir comptait alors 100 feux et 349 habitants (67 actifs, 260 femmes et enfants et 17 domestiques).
|
